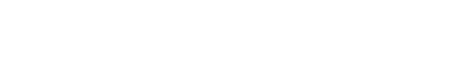Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
SoinsSantéCAN
Le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux
SoinsSantéCANMémoire présenté à Finance Canada pour les consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2022
RECOMMANDATIONS
Favoriser une meilleure intégration entre les soins de santé et la recherche en santé et exploiter le plein potentiel innovant et économique du secteur.
- Reconnaître les centres universitaires des sciences de la santé comme des entités indépendantes et autonomes et des moteurs de la croissance économique et les autoriser à rivaliser directement et sur un pied d’égalité avec d’autres secteurs pour obtenir un financement fédéral.
- Réaliser des investissements transformationnels dans la recherche en santé pour protéger les Canadiens contre les futures crises sanitaires et tirer parti des occasions économiques, en commençant par allouer un plancher annuel minimum de deux pour cent de la dépense publique en santé (3,7 milliards $), à la recherche en santé, aux initiatives stratégiques pour faire face aux questions sociales urgentes et à l’application des connaissances.
- Réinvestir dans la science fondamentale par l’entremise des trois conseils et transférer les investissements stratégiques en sciences à l’organisme canadien de recherche d’avant-garde.
- Faciliter la création de réseaux ou de pôles de la santé autour des hôpitaux de recherche et des organisations de soins de santé qui réunissent le milieu universitaire, l’industrie, les entreprises en démarrage et les incubateurs.
- Construire ou rénover des bâtiments afin de créer les laboratoires et les incubateurs indispensables pour attirer et réunir les chercheurs, les universités et les collèges, l’industrie, les innovateurs et les organisations à but non lucratif.
- Établir une stratégie de données pancanadienne pour la recherche en santé et créer un dépôt pancanadien de données de recherche en santé pour centraliser les données de la recherche en santé de tout le Canada.
Bâtir un système de santé plus inclusif, équitable, vert et résilient qui répond aux besoins de tous les Canadiens.
- Mettre en place une stratégie nationale de planification des effectifs en santé pour rassembler des données sur les effectifs afin de remédier à la pénurie de professionnels de la santé et de s’attaquer aux facteurs qui nuisent au recrutement et à la rétention.
- Moderniser les infrastructures en santé du Canada en augmentant les investissements en capitaux dans les soins de santé jusqu’à un minimum de 0,6 pour cent du PIB, au cours des cinq prochaines années, pour mieux s’aligner avec les homologues du Canada à l’OCDE.
- Augmenter les transferts en santé aux provinces et territoires pour assurer un financement cohérent et à long terme des soins de santé qui suit l’augmentation des coûts.
INTRODUCTION
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des hôpitaux, des organisations de soins de santé et des instituts de recherche en santé du Canada. En tant qu’association pancanadienne et non partisane, SoinsSantéCAN plaide en faveur de la recherche et de l’innovation en santé et d’un meilleur accès à des services de santé de grande qualité pour les Canadiens.
Alors que le Canada sort de la pandémie, il est essentiel que nous tirions parti des leçons apprises de la COVID-19 pour bâtir un meilleur système de santé. Le présent mémoire formule des recommandations pour aider le Canada à en sortir plus fort, à miser sur nos forces dans les domaines des soins de santé, de la recherche en santé et de l’innovation pour bâtir un système de santé plus inclusif, équitable, vert et résilient, ainsi qu’une économie basée sur le savoir qui attire les meilleurs talents et les investissements mondiaux et qui poursuit notre fière tradition de découvertes révolutionnaires en soins de santé dont profite le monde entier.
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES
1. Reconnaître les centres universitaires des sciences de la santé comme des entités indépendantes et autonomes et des moteurs de la croissance économique et les autoriser à rivaliser directement et sur un pied d’égalité avec d’autres secteurs pour obtenir un financement fédéral.
SoinsSantéCAN salue les investissements du gouvernement fédéral dans la recherche en santé et les biosciences au cours des 18 derniers mois et est particulièrement reconnaissante envers le Fonds d’urgence pour la continuité de la recherche au Canada dont ont profité de nombreux instituts de recherche. Toutefois, tant dans le passé que pendant la pandémie, le financement a surtout été accordé aux universités et à l’industrie privée et non aux centres universitaires de la santé (CUS) – notamment les organisations de prestations de soins de santé et les instituts de recherche – qui sont au centre de l’écosystème de la santé et des biosciences.
- Les CUS travaillent avec des chercheurs, des universités, des patients, des administrations publiques et le secteur privé en tant que pôles de l’innovation qui gardent les Canadiens en bonne santé et productifs.
- Malgré leur rôle pivot, les CUS n’ont pas un accès direct et égal au financement fédéral de la recherche et de l’innovation.
- Dans de nombreux cas, les CUS doivent demander un financement fédéral par l’intermédiaire de leur université affiliée, ce qui les désavantage puisque c’est l’université, qui a ses propres priorités de recherche, qui détermine en fin de compte les projets qu’elle soumettra.
- En conséquence, le plein potentiel des CUS et les avantages économiques du travail essentiel qu’ils accomplissent ne sont pas réalisés.
- Le secteur de la santé et des biosciences, s’il obtient le financement adéquat aux niveaux appropriés, assurera un avantage concurrentiel au Canada, attirera et retiendra les meilleurs talents, garantira des investissements mondiaux et bâtira l’économie fondée sur le savoir de l’avenir.
2. Réaliser des investissements transformationnels dans la recherche en santé pour protéger les Canadiens contre les futures crises sanitaires et tirer parti des occasions économiques, en commençant par allouer un plancher annuel minimum de deux pour cent de la dépense publique en santé (3,7 milliards $), à la recherche en santé, aux initiatives stratégiques pour faire face aux questions sociales urgentes et à l’application des connaissances.
La pandémie a montré les avantages de l’investissement dans la recherche et l’innovation en santé. Les chercheurs canadiens ont grandement contribué à la lutte mondiale contre la COVID-19, notamment en établissant pour la première fois le profil de la réponse immunitaire de l’organisme au virus et en développant la technologie des nanoparticules lipidiques pour acheminer l’ARNm dans les cellules de l’organisme – une percée basée sur 40 ans de recherche. Au sortir de la pandémie, des investissements importants et soutenus dans la recherche en santé peuvent propulser le Canada vers de nouveaux sommets et nous permettre de soutenir la concurrence internationale en tant que chefs de file de la recherche et de l’innovation, de bâtir l’économie basée sur le savoir de l’avenir et de trouver des solutions à nos problèmes de santé et nos problèmes sociaux les plus pressants.
- Le secteur de la santé et des biosciences est l’un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Il représente 3 % de l’emploi et contribue à hauteur de 7,8 milliards $ (0,45 %) au PIB annuel du Canada dans le cadre de l’écosystème élargi des soins de santé (12,7 % du PIB du Canada).1
- Le secteur crée des entreprises dérivées, produit la prochaine génération de personnel hautement qualifié et bâtit une économie du savoir qui attire les meilleurs talents et les investissements mondiaux.
- Le Canada se situe dans les derniers rangs des pays du G7 et de l’OCDE pour ce qui est de la dépense totale en recherche et développement exprimée en tant que pourcentage du PIB, cette dépense s’établissant à 1,5 % alors qu’elle est de 3 % aux États-Unis et à 1,8 % au Royaume-Uni.2
- Les budgets de la recherche en santé des concurrents internationaux ont été supérieurs à ceux du Canada, la COVID-19 ayant stimulé les investissements du Royaume-Uni et des États-Unis dans la recherche en santé.
3. Réinvestir dans la science fondamentale par l’entremise des trois conseils et transférer les investissements stratégiques en sciences à l’organisme canadien de recherche d’avant-garde.
La science fondamentale est essentielle à la croissance de notre économie de l’innovation; sans elle, le Canada continuera de se laisser distancer par ses homologues internationaux. Pourtant, toutes les promesses et tous les engagements du gouvernement fédéral dans le discours du Trône et les lettres de mandats portent sur la recherche à haut risque, à haut rendement et axée sur les priorités, et non sur la science fondamentale.
- Une proportion croissante des subventions de financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et des programmes fédéraux de recherche en santé vise à combler les lacunes dans les connaissances reliées à des objectifs ou des domaines de priorités fédéraux spécifiques, ce que l’on appelle aussi la « science stratégique ».
- Bien que cette recherche soit importante, elle limite le financement disponible pour la science fondamentale ou de base – la recherche fondée sur la curiosité qui tente de répondre aux questions « comment », « quoi » et « pourquoi » dans le but d’accroître les connaissances.
- L’insuffisance du financement a imposé un stress indu aux chercheurs, à leur personnel et à leurs étudiants. Les conséquences en sont que des chercheurs prometteurs ont été écartés des concours de subventions et que des recherches ont été retardées, abandonnées ou effectuées à l’étranger.
- Nous devons nous assurer qu’il existe un sain pipeline de talents si nous voulons que la recherche et l’innovation profitent à notre santé et à l’économie.
- Les IRSC et les autres organismes de financement fédéraux doivent revenir à leur rôle initial de principal organisme subventionnaire de la science fondamentale. Tout le financement de la science stratégique ou axée sur des priorités devrait être transféré à l’organisme canadien de recherche d’avant-garde.
- Ce changement d’orientation doit s’accompagner d’une importante injection de fonds aux IRSC pour compenser les décennies d’investissement minimal et s’assurer que les découvertes qui permettent d’allonger l’espérance de vie, d’améliorer la qualité de vie, d’accroître la productivité économique et la compétitivité du Canada sur la scène mondiale soient bien soutenues et bien financées.
4. Faciliter la création de réseaux ou de pôles de la santé autour des hôpitaux de recherche et des organisations de soins de santé qui réunissent le milieu universitaire, l’industrie, les entreprises en démarrage et les incubateurs.
Les hôpitaux de recherche et les organisations de soins de santé agissent comme des pôles de l’innovation puissants au sein du système de santé et du secteur de la recherche en santé et des sciences de la vie. Ils sont au centre de l’écosystème de la recherche en santé et des sciences de la vie, là où convergent les besoins pressants en matière de soins de santé et les innovations permettant de les satisfaire. Au sein des hôpitaux de recherche et des organisations de soins de santé, de nombreux chercheurs, universités, patients, sociétés et industries travaillent ensemble dans un contexte non concurrentiel pour stimuler le développement de nouvelles technologies et commercialiser des produits prometteurs pour améliorer les soins aux patients et la santé de la population de tout le Canada.
- Malgré le rôle important qu’ils jouent en matière d’innovation, les hôpitaux de recherche et les organisations de soins de santé ne sont que sporadiquement reconnus et inclus dans les programmes d’innovation fédéraux, selon les ministères gouvernementaux qui établissent ces programmes.
- La facilitation et le soutien des réseaux ou des pôles d’hôpitaux de recherche et d’organisations de soins de santé doivent être une priorité plus élevée dans le programme d’innovation du gouvernement fédéral.
- Une première étape serait de veiller à ce qu’au moins un des pô les de recherche qui reçoivent du financement dans le cadre du concours inaugural du Fonds de recherche biomédicale du Canada soit dirigé par un hôpital de recherche ou une organisation de soins de santé.
5. Construire ou rénover des bâtiments afin de créer les laboratoires et les incubateurs indispensables pour attirer et réunir les chercheurs, les universités et les collèges, l’industrie, les innovateurs et les organisations à but non lucratif.
Il y a une grave pénurie d’espaces de laboratoire au Canada. Les entrepreneurs, les incubateurs et les entreprises en démarrage s’adressent constamment aux hôpitaux de recherche du Canada dans l’espoir qu’ils pourront leur donner accès à leurs laboratoires. Malheureusement, les hôpitaux de recherche ne peuvent pas acquiescer à ces demandes. Pour tirer pleinement parti de la capacité d’innovation et du pouvoir économique du secteur de la recherche en santé et des sciences de la vie, il faut investir dans la construction ou la rénovation d’espaces existants pour créer des espaces dédiés aux incubateurs qui comprennent des laboratoires secs et humidesLes laboratoires secs sont ceux dans lesquels s’effectuent des analyses mathématiques appliquées ou computationnelles par la création de modèles informatiques ou de simulations. Les laboratoires humides sont ceux dans lesquels les médicaments, les produits chimiques et d’autres types de matières biologiques sont analysés et testés en utilisant divers liquides..
- Idéalement, les nouveaux espaces de laboratoire doivent être situés dans les hôpitaux de recherche ou les organisations de soins de santé, car c’est là que la science en santé se réalise et que de nouvelles idées sont conçues, et c’est là que sont situés les utilisateurs finaux – les patients, le personnel soignant et les cliniciens.
- Le regroupement de chercheurs, d’ingénieurs, d’entrepreneurs et d’entreprises mènera au développement organique de relations entre le système de santé, le milieu universitaire et le secteur privé tout en immergeant les personnes qui développent les innovations dans le système de santé là où se déploieront éventuellement leurs innovations pour améliorer les résultats pour les patients.
- Les liens étroits entre ces groupes et leur proximité avec le système de santé et les patients favoriseront également une meilleure application des connaissances, de sorte que la recherche et les innovations qui en découlent seront mises en oeuvre pour améliorer les résultats, ce qui permettra au Canada d’obtenir un plus grand rendement de ses investissements dans la recherche en santé.
6. Établir une stratégie de données pancanadienne pour la recherche en santé et créer un dépôt pancanadien de données de recherche en santé pour centraliser les données de la recherche en santé de tout le Canada.
De nombreuses entités canadiennes saisissent et stockent une quantité extraordinaire de données sur la santé à la grandeur du pays. Ce sont principalement des fournisseurs de soins, des cliniques, des hôpitaux, des services de santé publique et des gouvernements. Ces séries de systèmes distincts, cloisonnés et disjoints ont rendu inaccessibles et inutilisables des données précieuses sur la santé. La pandémie a incité le gouvernement fédéral à investir massivement dans les systèmes de données en santé, mais aucune approche ou stratégie coordonnée n’a été élaborée. Cette situation a un impact négatif sur les résultats en santé, en plus de freiner la recherche, d’entraver la prise de décisions en matière de santé publique et d’augmenter les coûts du système de santé.
- Un système de données numériques interopérable à haute performance est un vecteur déterminant dans les domaines de la santé et de la recherche en santé, mais les chercheurs n’ont pas les outils pour partager efficacement les données et l’information entre les établissements et les divisions provinciales et territoriales.
- La Table de stratégie économique sur la santé et les sciences biologiques (SSB) est l’une des tables stratégiques qui ont demandé au gouvernement de créer un système de données interopérable en santé. Elle a proposé plusieurs mesures touchant tout le secteur pour libérer l’innovation, dont l’une portait sur la création d’une stratégie numérique de santé nationale comprenant une plateforme de santé numérique interopérable.
- Dans son deuxième rapport, le Comité consultatif d’experts sur la Stratégie pancanadienne de données sur la santé de l’Agence de la santé publique du Canada déterminait que l’interopérabilité entre les juridictions était l’épine dorsale des données sur la santé dans le système de santé.
- La stratégie actuelle consistant à mettre en oeuvre la technologie numérique en santé sur une base de services compromet les soins individuels et la santé à l’échelle de la population.
- Nous appuyons les recommandations formulées dans les rapports de la Table de stratégie SSB et de l’Agence de la santé publique du Canada mentionnés ci-dessus. La mise en oeuvre d’une stratégie nationale de données sur la santé qui permet l’interopérabilité entre les établissements, les administrations et les gouvernements enrichira la qualité et la disponibilité des données et de la recherche en santé et favorisera les partenariats et la collaboration nécessaires pour stimuler l’innovation qui permettra de relever les défis les plus pressants en matière de santé au Canada.
7. Mettre en place une stratégie nationale de planification des effectifs en santé pour rassembler des données sur les effectifs afin de remédier à la pénurie de professionnels de la santé et de s’attaquer aux facteurs qui nuisent au recrutement et à la rétention.
Les professionnels des soins de santé sont la plus grande ressource du système de santé, mais le Canada planifie mal les effectifs de la santé. Les conséquences de ce piètre travail se sont fait cruellement sentir pendant la pandémie et continuent de nuire à la prestation de soins de qualité. En l’absence d’une stratégie nationale, il est difficile d’assurer que le bon nombre et le bon type de travailleurs sont au bon endroit au bon moment. Cette situation a des ramifications économiques et perpétue les inégalités actuelles dans le système de santé, notamment pour les travailleurs qui sont principalement des femmes et, dans certains postes à bas revenus, des immigrants, des nouveaux arrivants et des personnes racialisées, de manière disproportionnée.
- À la fin de 2020, le nombre de postes vacants dans le secteur des soins de santé a atteint un record pour s’établir à 100 300, une hausse de 56,9 % par rapport à l’année précédente, ce qui démontre la gravité de la pénurie de travailleurs de la santé au Canada.3
- Les répercussions de la pandémie, notamment l’augmentation du stress et de l’épuisement professionnel, ont amené de nombreux travailleurs des soins de santé à quitter le secteur. De nombreux autres disent qu’ils le quitteront une fois la pandémie terminée. Cette situation à des incidences énormes sur l’accès aux soins et la qualité des soins.
- Les problèmes d’effectifs en santé du Canada, y compris les pénuries d’effectifs et les taux élevés de problèmes de santé mentale chez les travailleurs des soins de santé, existaient déjà avant la pandémie et ils ont une incidence sur le recrutement et la rétention.
- La création d’un organisme de coordination national pour faciliter la collecte de données normalisées et la planification stratégique contribuera à remédier aux pénuries de maind’oeuvre actuelles et à améliorer les conditions de travail.
8. Moderniser les infrastructures en santé du Canada en augmentant les investissements en capitaux dans les soins de santé jusqu’à un minimum de 0,6 pour cent du PIB, au cours des cinq prochaines années, pour mieux s’aligner avec les homologues du Canada à l’OCDE.
Le défaut du Canada de maintenir des investissements en capital adéquats dans ses installations de soins de santé nuit à notre environnement, a des conséquences sur les soins aux patients et compromet gravement notre capacité de soutenir un système de soins de santé innovant et technologiquement avancé. La pandémie a montré que la désuétude des infrastructures de santé pose des risques pour la santé des Canadiens, y compris dans les nombreux établissements de soins de longue durée où il est presque impossible de respecter les protocoles de prévention et de contrôle des infections.
- Le Canada se classe au troisième rang mondial pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre par habitant provenant du secteur des soins de santé, ces émissions comptant pour quelque 4 % des émissions totales du pays.4
- Les émissions des hôpitaux à elles seules représentent 21 228 kilotonnes d’équivalents de dioxyde de carbone ou 8 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur non commercial ou des ménages et 538 031 térajoules ou 11 % de la consommation d’énergie du secteur non commercial ou des ménages.5
- L’âge des installations de soins de santé est un facteur contributif. Ce sont les infrastructures publiques parmi les plus anciennes utilisées aujourd’hui. Environ 48 % d’entre elles ont été construites il y a plus de 50 ans; dans les villes, ce sont près de 70 %.
- Au cours des 20 dernières années, les investissements canadiens en infrastructures de la santé ont fluctué et ont subi une baisse notable au cours des dernières années malgré la hausse constante des dépenses globales en soins de santé au cours de la même période.6 Cela suggère que les investissements en capital ont été sacrifiés pour financer les frais d’exploitation. De fait, il faudra continuer de réaffecter des fonds à la prestation des soins au fur et à mesure de l’augmentation et du vieillissement de la population.
Par ailleurs, le Canada doit également accélérer les efforts pour mettre en place une infrastructure de la santé numérique et renforcer la cybersécurité afin de rationaliser le système de santé, de soutenir les soins virtuels, d’améliorer l’accès et de faciliter le partage sécuritaire des données en santé avec les praticiens et avec les patients.
- La COVID-19 a accéléré l’adoption des soins virtuels et mis leurs nombreux avantages en évidence, comme la commodité, l’élimination de certains obstacles à l’accès et le suivi des patients à distance. Les soins virtuels sont également bien appréciés des Canadiens.
- En 2019, les soins virtuels ont permis aux Canadiens et à l’économie d’épargner 11,5 millions d’heures du seul fait que les gens n’avaient pas à s’absenter du travail pour se rendre à des rendez-vous en personne. Ils ont également entraîné une réduction des émissions de CO2 de 120 000 tonnes métriques.7
- Si 50 % des visites de soins primaires s’effectuaient en mode virtuel au Canada, on prévoit que les économies annuelles s’établiraient à 103 millions d’heures pour les Canadiens et l’économie, en plus de réduire de 325 000 tonnes métriques les émissions de CO27.
- Avec la hausse des cybermenaces dans le secteur de la santé pendant la pandémie, il est essentiel de renforcer la cybersécurité dans le cadre du passage à une plus grande infrastructure numérique et aux soins virtuels.
9. Augmenter les transferts en santé aux provinces et territoires pour assurer un financement cohérent et à long terme des soins de santé qui suit l’augmentation des coûts.
La COVID-19 a mis à jour la fragilité de notre système de soins de santé et a exacerbé les problèmes systémiques de longue date, comme l’accès inadéquat aux services de santé mentale et la nécessité de revoir les soins aux personnes âgées. Elle a également aggravé les retards de chirurgie et d’interventions, et il est probable que d’autres répercussions à long terme apparaîtront dans les mois et les années à venir. Par contre, elle a aussi montré que tous les ordres de gouvernement peuvent agir rapidement et travailler ensemble afin de résoudre des problèmes urgents.
Les transferts en santé additionnels effectués de manière ponctuelle par le gouvernement fédéral pendant la pandémie sont appréciés. Toutefois, alors que nous émergeons de la pandémie, nous avons besoin d’un financement fédéral supplémentaire soutenu et d’une collaboration gouvernementale pour combler les lacunes actuelles et bâtir un système de santé qui répond aux besoins actuels et futurs des Canadiens, surtout dans le contexte du vieillissement de la population.
- Le Transfert canadien en matière de santé n’a pas suivi le rythme de l’augmentation des coûts des soins de santé causée par l’inflation, la croissance démographique, le vieillissement de la population, l’état de santé de la population et les améliorations du système de santé.
- Au cours de la prochaine décennie, la COVID-19 augmentera les coûts de santé, car le Canada continuera de dépenser pour atténuer les impacts du virus, rattraper les retards et traiter les nouvelles complications de santé chez les patients atteints de la COVID-19. On prévoit que les dépenses en santé augmenteront à un taux annuel moyen se situant entre 6,5 % et 8,4 % à court terme et entre 5,5 % et 5,7 % à long terme.8
- Il n’est pas réaliste de penser que les provinces et les territoires peuvent assumer ces coûts à eux seuls. Le gouvernement fédéral devra accorder un financement additionnel pour remédier aux lacunes mises en évidence par la pandémie et aux impacts à long terme de la COVID-19, en plus des tendances actuelles qui font augmenter les coûts des soins de santé, comme le vieillissement de la population.
CONCLUSION
Comme nous l’avons appris pendant la pandémie, une population en santé et une économie saine vont de pair. L’investissement dans un système de santé inclusif, équitable, vert et résilient et l’exploitation de la capacité innovante et économique du secteur de la santé et des biosciences – y compris les CUS – assureront la vigueur de notre économie en créant des emplois, en stimulant les économies locales, en attirant les meilleurs talents et les investissements mondiaux et en positionnant le Canada comme un chef de file de la recherche et de l’innovation en santé.
RÉFÉRENCES
- Table sectorielle de stratégies économiques – Santé et sciences biologiques. 2017. Situation actuelle et possibilités d’avenir : rapport provisoire. https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Table_SB.pdf/$file/ISEDC_Table_SB.pdf
Karima Es Sabar. How to ensure Canada’s health sector remains an engine of economic prosperity. Corporate Knights. March 26, 2021. https://www.corporateknights.com/channels/leadership/canadas-growing-health-sector-is-an-engine-for-post-pandemic-economic-prosperity-16167719/. - OCDE. 2021. Dépenses intérieures brutes de RD (indicateurs). https://data.oecd.org/fr/rd/depenses-interieures-brutes-de-r-d.htm.
- Statistique Canada. 2020. Postes vacants, quatrième trimestre de 2020. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210323/dq210323b-fra.htm
- Howard, Courtney et al. 2019. The Lancet Countdown on Health and Climate Change Policy brief for Canada. https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/11/Lancet-Countdown_Policy-brief-for-Canada_FINAL.pdf.
- Statistique Canada. 2012. Émissions de gaz à effet de serre, selon le secteur. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810011101&request_locale=fr; Statistique Canada. 2012. Utilisation de l’énergie, selon le secteur. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810010901&request_locale=fr.
- Teja B. et al. 2020. Ensuring adequate capital investment in Canadian health care. CMAJ Jun 2020, 192 (25) E677-E683. https://doi.org/10.1503/cmaj.191126.
- Inforoute santé du Canada. 2020. Analysis of the current and potential benefits of virtual care in Canada. https://www.infoway-inforoute.ca/en/component/edocman/3819-analysis-of-the-current-and-potential-benefits-of-virtual-care-in-canada/view-document?Itemid=101.
- Le Conference Board du Canada. 2020. Health Care Cost Drivers in Canada: Pre-and Post-COVID-19. https://www.canadaspremiers.ca/wp-content/uploads/2020/10/CBOC_impact-paper_research-on-healthcare_final.pdf.
PRÉSENTÉ
le 23 février 2022
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Bianca Carlone
Analyste des relations gouvernementales et des politiques
bcarlone@healthcarecan.dev2.inter-vision.ca
Jonathan Mitchell
Vice-président, Recherche et politiques
jmitchell@healthcarecan.dev2.inter-vision.ca
Related:
Mémoire présenté au gouvernement fédéral dans le cadre de la Consultation sur la puissance de calcul pour l’intelligence artificielle (IA)

Mémoire présenté au Comité permanent des finances dans le cadre des consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2025