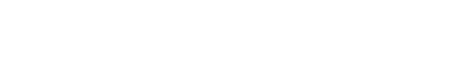Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
SoinsSantéCAN
Le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux
SoinsSantéCANPrésentation au Comité permanent de la santé : Étude sur la santé des enfants
APERÇU
SoinsSantéCAN, le porte-parole national des hôpitaux de recherche et des organisations de soins de santé du Canada, est heureux de pouvoir présenter ce mémoire au Comité permanent de la santé dans le cadre de son étude sur la santé des enfants.
Au cours des deux dernières années, bon nombre de nos organisations de soins de santé membres, dont celles qui fournissent des soins aux enfants et aux jeunes, se sont exprimées encore plus fort sur l’incidence de la pandémie sur le bien-être physique, mental, émotionnel, développemental et social des jeunes. Les enfants et les jeunes ont dû faire face à de nombreux changements, souvent rapides, sur une période relativement courte. Ces changements ont mis à mal de nombreuses personnes, et les organisations de soins de santé ont travaillé dur pour répondre à leurs besoins.
Les services de santé destinés aux enfants et aux jeunes étaient déjà fortement sollicités avant la pandémie et l’ont été encore plus au cours des deux dernières années en raison de la demande accrue. Les enfants et les jeunes forment un groupe démographique unique et ont leurs propres besoins en matière de soins de santé; il faut agir immédiatement pour renforcer les services dont ils ont besoin. À cet égard, SoinsSantéCAN appuie entièrement le mémoire présenté par Santé des enfants Canada, qui est également une de ses organisations membres.
En tant qu’association représentant des organisations de soins de santé et s’intéressant au système de santé dans son ensemble, SoinsSantéCAN préconise plusieurs changements systémiques majeurs qui permettraient également d’améliorer considérablement les services de santé offerts aux enfants et aux jeunes. Ces recommandations sont présentées dans le présent mémoire.
RECOMMANDATIONS
Personnel de santé
1. Améliorer le processus d’immigration et de délivrance des titres, des certificats et des licences afin de mieux tirer parti des compétences des immigrants et des nouveaux arrivants pour répondre aux besoins actuels du système de santé à court et à moyen terme.
Les organisations de soins de santé sont impatientes de tirer parti des compétences des immigrants et des nouveaux arrivants pour répondre aux besoins immédiats en ressources humaines dans le domaine de la santé. Il existe toutefois des obstacles qui entravent sérieusement le recrutement de travailleurs de la santé formés à l’étranger. Il faut notamment que les organisations de soins de santé sachent lesquels des nouveaux arrivants au Canada possèdent les compétences et l’expérience recherchées dans le domaine de la santé, et qu’elles passent par le processus complexe de délivrance des titres, des certificats et des licences.
Il est essentiel de simplifier et d’adapter davantage les solutions aux processus d’immigration et de délivrance des titres, des certificats et des licences pour remédier à court terme aux pénuries de personnel de santé, notamment dans le domaine de la santé des enfants.
2. Soutenir la coordination interprovinciale et interterritoriale de l’éducation et de la délivrance de licences.
Pendant la pandémie, des mesures ont été mises en oeuvre pour faciliter le déplacement des travailleurs de la santé entre les provinces et les territoires afin d’aider les régions les plus durement touchées. De façon similaire, les processus nécessaires ont été mis en oeuvre pour aider les fournisseurs qui ont dû passer à la prestation de soins virtuels au début de la pandémie.
Ces démarches ont bien fonctionné, et le Canada ne peut se permettre de revenir au statu quo prépandémique une fois la pandémie derrière nous. Nous devons rendre permanentes des solutions qui étaient auparavant considérées comme des solutions temporaires, notamment des mesures visant à soutenir la mobilité du personnel de santé et la prestation virtuelle de services de santé entre les provinces et les territoires.
Les gouvernements, les organismes de réglementation, les établissements d’enseignement, les associations professionnelles, les employeurs et les syndicats doivent travailler ensemble pour réduire les obstacles juridictionnels afin de s’adapter à l’évolution du système et des besoins des patients, notamment en améliorant la coordination de l’enseignement des soins de santé et de la délivrance des licences. Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de premier plan en réunissant les intervenants et en facilitant la mise en oeuvre de solutions.
3. Collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes de réglementation et les établissements d’enseignement afin de former davantage de professionnels de la santé canadiens dans les professions et les spécialités nécessaires pour répondre aux besoins à long terme du système de santé.
À long terme, le Canada doit former davantage de travailleurs de la santé, notamment un plus grand nombre de fournisseurs spécialisés dans la santé des enfants et des jeunes. Pour ce faire, il faut augmenter le nombre de places dans les programmes universitaires et collégiaux pour toutes les professions de la santé, élargir l’accès à ces programmes pour les groupes marginalisés, les Autochtones et les autres groupes racisés et réduire les obstacles auxquels ils se heurtent, et améliorer les aides afin de maximiser les possibilités de formation postuniversitaire et de stage.
De façon similaire, la mise en place de campagnes visant à familiariser les jeunes avec les emplois du secteur de la santé et l’octroi d’incitations financières et autres à ceux qui envisagent de faire carrière dans le domaine de la santé peuvent contribuer à attirer des personnes vers les postes de ce domaine. L’octroi d’une aide supplémentaire aux étudiants tout au long de leurs études et de leur formation, y compris des incitations financières, des subventions et des programmes d’allègement des frais de scolarité, est une autre mesure quipeut encourager les gens à faire carrière dans le secteur de la santé.
4. Mettre en oeuvre une stratégie pancanadienne de planification du personnel de santé.
Le Canada a du mal à planifier le personnel de santé et à recueillir les données. Sans stratégie pancanadienne relative au personnel de santé, il est difficile d’assurer la bonne combinaison de travailleurs de la santé pour répondre aux besoins actuels et futurs. Cette situation nuit aux soins aux patients, entraîne de mauvaises conditions de travail pour les travailleurs de la santé, a des répercussions économiques pour le Canada et perpétue les inégalités actuelles dans le système de santé, tant pour les travailleurs de la santé que pour les patients.
Le Canada est loin derrière ses pairs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en ce qui concerne la collecte de données, les infrastructures et l’analyse des données sur le personnel de santé1. De nombreux pays, comme l’Australie2, entreprennent la planification du personnel de santé à l’échelle nationale et disposent d’organismes dédiés à la collecte et à l’analyse de données sur le personnel de santé, à la réalisation de travaux de recherche, à la prévision des besoins du système de santé et à l’élaboration de politiques visant à renforcer le personnel et le système de santé.
Il existe des modèles de planification du personnel dans d’autres secteurs canadiens, comme ConstruForce Canada dans le secteur de la construction, qui pourraient servir de base à l’élaboration d’une stratégie de planification du personnel de santé3.
Une stratégie pancanadienne de planification du personnel de santé permettra de mieux comprendre les pénuries de main-d’oeuvre et les facteurs qui y contribuent, et aidera à mettre au point des solutions pour que le Canada dispose de la main-d’oeuvre dont il a besoin pour offrir des services de santé aux enfants et aux jeunes. Elle permettra également d’avoir une idée des besoins futurs et aidera à élaborer des stratégies pour que le Canada dispose du personnel de santé dont il a besoin pour répondre à la demande future. Le bon fonctionnement du système de santé et la prestation de soins de haute qualité aux enfants et aux jeunes passent par un système de santé bien pourvu en personnel, avec des travailleurs qui se sentent bien mentalement et physiquement.
Recherche et innovation dans le domaine de la santé
5. Faire des investissements évolutifs dans la recherche en santé, en commençant par un plancher annuel minimum de 2 % des dépenses publiques en santé (3,7 milliards de dollars), réparti également entre la recherche en santé, l’application des connaissances et les initiatives stratégiques visant à s’attaquer aux problèmes sanitaires et sociaux urgents.
La COVID-19 a suscité un nouvel intérêt et une augmentation des investissements dans la recherche en santé aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui dépassent ceux du Canada. Le Royaume-Uni a annoncé qu’il investira 14,6 milliards de livres sterling (environ 24,4 milliards de dollars canadiens) dans la recherche et le développement en 2021-2022 et s’est engagé à porter le financement des sciences à 2,4 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2027.Le budget fédéral de 2018, ici au Canada, a augmenté le budget annuel des IRSC d’un peu plus de 1 % en 2020-2021 pour le porter à 1,2 milliard de dollars. On s’attend à ce qu’il reste ainsi à l’avenir. Ce budget et cet investissement limités dans la recherche en santé laissent peu de ressources à répartir entre les chercheurs canadiens.
Dans le cadre du concours de subventions Projet du printemps 2020, le taux de réussite pour l’obtention d’une subvention des IRSC n’était que de 15,8 %. Sur les 2 130 demandes soumises, seules 336 demandes de subvention des IRSC ont été retenues. Un grand nombre de projets de recherche prometteurs, notamment sur la santé des enfants et des jeunes, demeurent inachevés en raison du manque de financement des chercheurs et des innovateurs canadiens.
6. Améliorer l’interopérabilité des systèmes de santé pour favoriser la création de partenariats, notamment par la mise en place d’un dépôt pancanadien de données de recherche en santé.
Les réseaux entre les chercheurs en santé du Canada sont bien établis, mais il leur manque les outils nécessaires pour communiquer et échanger des données et des renseignements de façon efficace entre les établissements et les provinces et territoires.
L’élaboration d’une stratégie nationale en matière de données sur la santé qui permet l’interopérabilité entre les établissements, les provinces et territoires, et les gouvernements est recommandée par la Table de stratégies économiques pour le secteur des sciences biologiques et de la santé et par le Comité consultatif d’experts sur la Stratégie pancanadienne de données sur la santé de l’Agence de la santé publique du Canada. Cette démarche permettra de renforcer la qualité et la disponibilité des données et des travaux de recherche sur la santé, et de favoriser les partenariats et la collaboration nécessaires pour stimuler l’innovation qui permettra de relever les défis les plus urgents en matière de santé au Canada, notamment la crise sanitaire touchant actuellement les enfants.
Le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de premier plan en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à la mise en place d’un dépôt pancanadien de données.
Infrastructures
7. Veiller à ce que le financement des infrastructures profite au secteur de la santé en offrant aux organisations de soins de santé un accès direct et égal au financement fédéral des infrastructures.
Les organisations de soins de santé ne peuvent pas toujours accéder directement au financement fédéral des infrastructures. Elles dépendent donc des fonds qui sont alloués aux provinces et aux territoires, et éventuellement aux municipalités, pour améliorer les infrastructures de soins de santé. Or, cette situation présente des lacunes, car ces gouvernements – qui doivent s’occuper de nombreux projets d’infrastructure – négligent souvent la nécessité d’investir dans les établissements de santé, pensant peut-être que les budgets de santé couvriront les travaux de rénovation de ces bâtiments publics essentiels.
Un accès direct et égal à tous les fonds d’infrastructure fédéraux pour les établissements desoins de santé est essentiel pour garantir que les projets d’infrastructure de tous les secteurs peuvent concurrencer sur un même pied d’égalité pour les investissements fédéraux.
8. Augmenter les investissements en capital dans les soins de santé à un minimum de 0,6 % du PIB (environ 12,5 milliards de dollars) pour qu’ils se rapprochent de ceux des autres pays de l’OCDE.
L’investissement du Canada dans les infrastructures de soins de santé a diminué au cours des dernières années, alors que les dépenses globales dans ce secteur ont augmenté de façon constante. Contrairement à la tendance des pays de l’OCDE à augmenter les investissements en capital depuis 2010, le Canada a investi 14 % de moins en dollars constants en 2019 par rapport à 20104.
Quant à l’investissement dans les infrastructures de soins de santé en pourcentage du PIB, le Canada se situe sous la moyenne de l’OCDE de 0,6 %, à 0,5 %, et est loin derrière bon nombre de nos plus importants homologues mondiaux, notamment la France (0,6 %), les États-Unis (0,7 %), l’Australie (0,8 %) et l’Allemagne (1,1 %)5.
Les organisations de soins de santé ont ressenti les effets de la diminution des investissements en capital, l’entretien différé accumulé pour les seuls hôpitaux étant estimé à environ 28 milliards de dollars en 20156. Le fait de ne pas investir suffisamment dans le capital compromet la capacité de fournir aux patients des normes de soins acceptées ou nouvelles, en particulier lorsque celles-ci nécessitent des technologies coûteuses pour le diagnostic et le traitement7.
Les deux principales sources de revenus pour les investissements en capital dans les soins de santé sont les mêmes depuis cent ans : les dons de charité et la fiscalité. Ces deux sources de revenus fluctuent dans le temps et ne constituent pas une source de financement stable, ce à quoi les gouvernements doivent remédier.
Des infrastructures modernes sont essentielles pour améliorer l’accès aux services et l’évolution de l’état de santé des patients. Le gouvernement fédéral doit augmenter les investissements dans les infrastructures de santé, car il s’agit d’un élément essentiel pour améliorer la santé des enfants et le système de santé en général.
9. Développer les soins virtuels et améliorer les technologies de l’information et les infrastructures numériques dans l’ensemble du système de santé.
Le développement des soins virtuels et des options de santé numérique, provoqué par la COVID19, a eu pour effet positif de permettre aux praticiens et aux chercheurs de fournir de meilleurs soins aux patients, de faciliter la recherche et les traitements et d’accroître la collaboration.
Cette démarche est bien populaire auprès des jeunes. Un commentaire publié en juillet 2021 indique que les jeunes Canadiens âgés de 13 à 17 ans avec lesquels les auteurs se sont entretenus ont retiré plusieurs avantages de l’utilisation des soins virtuels et ont exprimé le souhait de les maintenir une fois la pandémie terminée8.
Le développement des soins virtuels ne sera pas possible sans une infrastructure numérique qui prend en charge les nouvelles technologies et les nouveaux outils et permet l’échange de renseignements entre les établissements et les provinces et territoires. Il faudra améliorer les technologies de l’information et l’infrastructure numérique actuelles, ce qui nécessitera des investissements de la part de tous les ordres de gouvernement. Le gouvernement fédéral doit également jouer un rôle de premier plan pour faciliter ce travail avec les différents intervenants et ordres de gouvernement.
RÉFÉRENCES
- Bourgeault, I.L. « A path to improved health workforce planning, policy and management in Canada: The critical co-ordinating and convening roles for the federal government to play in addressing eight per cent of its GDP », The School of Public Policy Publications, volume 14, numéro 1, le 17 décembre 2021. Récupéré de : https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/sppp/article/view/74064.
- Crettenden, I. F., McCarty, M. V., Fenech, B. J., Heywood, T., Taitz, M. C., et Tudman, S. 2014. « How evidence-based workforce planning in Australia is informing policy development in the retention and distribution of the health workforce », Human resources for health, volume 12, numéro 7. Récupéré de : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3922608/.
- ConstruForce Canada. Bienvenue chez ConstruForce Canada, 2019. Récupéré de : https://www.buildforce.ca/fr; Bourgeault, A path to improved health workforce planning.
- Teja B. et coll. 2020. « Ensuring adequate capital investment in Canadian health care », CMAJ, volume 192, numéro 25, E677-E683, juin 2020. Récupéré de : https://www.cmaj.ca/content/192/25/E677.
- OCDE. « Panorama de la santé 2021 : Les indicateurs de l’OCDE », Publication de l’OCDE, Paris, 2021. Récupéré de : https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2021_fea50730-fr.
- Teja, « Ensuring adequate capital investment ».
- Ibid.
- Fletcher, S.E., Tsand, V.W.L. « The era of virtual care: Perspectives of youth on virtual appointments in COVID-19 and beyond », Pediatric & Child Health, volume 26, numéro 4, p.210-213, 2021. Récupéré de : https://doi.org/10.1093/pch/pxaa138.
PRÉSENTÉ
le 12 avril 2022
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Bianca Carlone
Analyste des relations gouvernementales et des politiques
bcarlone@healthcarecan.dev2.inter-vision.ca
Jonathan Mitchell
Vice-président, Recherche et politiques
jmitchell@healthcarecan.dev2.inter-vision.ca
Related:
Mémoire présenté au gouvernement fédéral dans le cadre de la Consultation sur la puissance de calcul pour l’intelligence artificielle (IA)

Mémoire présenté au Comité permanent des finances dans le cadre des consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2025