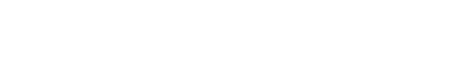Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
SoinsSantéCAN
Le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux
SoinsSantéCANPrésentation à la consultation budgétaire 2021
RECOMMANDATIONS
- Reconnaisse les centres universitaires des sciences de la santé comme des entités indépendantes autonomes et des moteurs de la croissance économique et les autorisent à concurrencer directement et sur un pied d’égalité avec d’autres secteurs pour obtenir un financement fédéral.
- Investisse dans la recherche en santé à un niveau équivalent à deux pour cent des dépenses publiques en santé (3,7 milliards $), répartis en parts égales entre la recherche en santé (1,85 milliard $) et l’application des connaissances pour l’innovation en santé (1,85 milliard $).
- Mette en oeuvre les recommandations reliées au secteur de la santé et des biosciences dans le rapport du Conseil sur la stratégie industrielle intitulé Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens : Un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante.
- Veille à la mise en place de soutiens et de programmes appropriés en matière de santé mentale afin d’aider les travailleurs de la santé, maintenant, et une fois la pandémie terminée.
- De concert avec les parties prenantes, contre les facteurs qui contribuent à l’augmentation du stress, de l’anxiété, de la dépression et de l’épuisement professionnel chez les travailleurs des soins de santé.
- Mette en oeuvre une stratégie nationale de ressources humaines en santé pour remédier à la pénurie de professionnels de la santé, créer un système de santé plus inclusif et plus résilient, et réaliser la promesse de votre gouvernement voulant que chaque Canadien ait accès à un médecin de famille ou à une équipe de soins de santé primaires.
- Augmente les transferts en santé aux provinces et territoires et, au minimum, maintienne la part fédérale du financement au fil du temps.
- Modernise l’infrastructure en santé du Canada et au cours des cinq prochaines années, augmente les investissements en capital dans les soins de santé à un minimum de 0,6 pour cent du PIB pour mieux aligner le Canada sur les comparateurs de l’OCDE.
INTRODUCTION
Alors que la COVID-19 continue d’affecter la vie des Canadiens, on n’a jamais porté autant d’attention aux soins de santé. Le virus a révélé les failles de notre système de santé et a mobilisé les Canadiens pour exiger mieux de leurs gouvernements. La pandémie offre une occasion de repenser les soins de santé et leur mode de prestation – et le Canada ne peut pas se permettre de la laisser passer. Il y a un risque réel qu’une fois la pandémie terminée, le public et les gouvernements oublient rapidement à quel point les soins de santé et la recherche en santé sont essentiels à notre réussite en tant que nation et reviennent à leurs pratiques prépandémiques consistant à ignorer et à sous-financer le système de santé.
Le secteur de la santé et des biosciences a le pouvoir d’agir comme un moteur de l’innovation et de l’économie qui peut aider le Canada à bâtir en mieux. Il est tout aussi important de le reconnaître que de résoudre les problèmes du système de santé du Canada.
La COVID-19 a montré le besoin d’un système de santé plus résilient et plus souple, un système qui possède l’expertise, les ressources et les infrastructures pour répondre aux situations d’urgence et aux pandémies. Alors que le Canada émerge de la pandémie et qu’il établit le plan de relance du Canada, le gouvernement fédéral doit mettre à profit la dynamique qui s’est créée pendant cette période pour transformer notre système de santé et exploiter tout le potentiel du secteur de la santé et des biosciences.
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES
EXPLOITER LE POUVOIR INNOVANT ET ÉCONOMIQUE DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES BIOSCIENCES
Le secteur de la santé et des biosciences contribue à hauteur de 3 milliards $ par année à l’économie du Canada; il emploie un Canadien sur huit et il représente 11 pour cent du PIB annuel du pays. Le secteur crée également de nouvelles petites et moyennes entreprises, produit la prochaine génération de personnel hautement qualifié (PHQ) et contribue à la création d’une économie fondée sur le savoir qui attire les meilleurs talents et des investissements mondiaux.
Le Conseil sur la stratégie industrielle du Canada, qui s’est réuni en juin 2020 pour mieux comprendre l’impact de la COVID-19 sur l’économie et l’industrie, reconnaît le secteur de la santé et des biosciences comme un secteur d’investissement clé dans son rapport Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens : Un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante. Le rapport souligne la réussite de ce secteur au cours des dernières années et recommande des investissements sur les 12 à 18 prochains mois dans ce secteur que ce rapport, tout comme le Conseil consultatif sur la croissance économique, identifie comme l’un des domaines de force du Canada. Le Conseil sur la stratégie industrielle souligne que « le Canada compte des sociétés en santé et en biosciences ayant l’avantage scientifique pour devenir des entreprises phares d’envergure internationale en biotechnologie », mais qu’il lui reste encore à en tirer pleinement parti grâce à « une production à valeur ajoutée à grande échelle1. » Dans l’ensemble, le rapport reprend la position défendue de longue date par SoinsSantéCAN selon laquelle il est important de renforcer la capacité du secteur en tant que moteur économique par des investissements et par l’expansion et la modernisation des principaux programmes gouvernementaux qui soutiennent mieux la recherche et la collaboration croisée avec le secteur privé.
Les membres de SoinsSantéCAN sont des centres universitaires des sciences de la santé, plus particulièrement des organisations de prestation de soins de santé et des instituts de recherche, qui sont au centre de l’écosystème de la santé et des biosciences, et qui collaborent avec des chercheurs, des universités, des patients, des gouvernements et des entreprises privées en tant que pôles d’innovation qui maintiennent les populations canadiennes en bonne santé et productives. Malgré leur rôle central, ces organisations n’ont pas un accès égal au financement fédéral en matière de recherche et d’innovation. Bien souvent, les centres universitaires des sciences de la santé doivent demander un financement fédéral par l’entremise de leur université affiliée, ce qui les désavantage, puisque l’université, qui a ses propres priorités de recherche, décide en premier lieu des projets qui feront l’objet d’une demande de financement. En conséquence, les centres universitaires des sciences de la santé ne réalisent pas tout leur potentiel et l’économie ne profite pas de l’impact positif de leur travail essentiel. Avec des investissements adéquats et à des niveaux appropriés, la recherche en santé et, plus largement, le secteur de la santé et des biosciences, assureront un avantage concurrentiel au Canada et nous permettront d’attirer et de retenir les meilleurs talents et d’obtenir des investissements mondiaux.
Recommandation 1 : Reconnaître les centres universitaires des sciences de la santé comme des entités indépendantes autonomes et des moteurs de la croissance économique et les autoriser à concurrencer directement et sur un pied d’égalité avec d’autres secteurs pour obtenir un financement fédéral. Cette recommandation pourrait être mise en oeuvre par une modification à la politique actuelle.
Recommandation 2 : Investir dans la recherche en santé à un niveau équivalent à deux pour cent des dépenses publiques en santé (3,7 milliards $), répartis en parts égales entre la recherche en santé (1,85 milliard $) et l’application des connaissances pour l’innovation en santé (1,85 milliard $).
Recommandation 3 : Mettre en oeuvre les recommandations reliées au secteur de la santé et des biosciences dans le rapport du Conseil sur la stratégie industrielle intitulé Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens : Un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante.
SOUTENIR LES TRAVAILLEURS DES SOINS DE SANTÉ ET RENFORCER LA CAPACITÉ DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
Au cours de la dernière année, la résilience de notre système de santé et nos travailleurs des soins de santé ont été mis à l’épreuve comme jamais auparavant. Les travailleurs des soins de santé travaillent sans relâche depuis mars dernier, les hôpitaux de tout le pays fonctionnent à des niveaux historiques de surcapacité et nos établissements de soins de longue durée luttent pour contenir le virus et offrir les soins de base à leurs résidents. Nous avons fait porter une grande partie du fardeau de cette pandémie à nos travailleurs des soins de santé et pendant qu’ils en ont supporté le poids, ils l’ont fait à leur propre détriment.
Dans les derniers mois, ces travailleurs ont déclaré subir des niveaux accrus de stress, d’anxiété, de dépression et d’épuisement professionnel. Des études effectuées partout dans le monde, y compris au Canada, abondent dans le même sens et révèlent que ces problèmes étaient préoccupants avant la pandémie et qu’ils sont exacerbés par celle-ci2. Les membres de SoinsSantéCAN, qui exploitent des hôpitaux, des instituts de recherche, des organisations de soins de longue durée et des autorités sanitaires, s’inquiètent de la santé mentale et du bien-être de leur personnel et nombre d’entre eux prévoient que la vague finale de cette pandémie sera une crise de santé mentale qui affectera notre main-d’oeuvre de la santé. Les conséquences néfastes de la COVID-19 sur les travailleurs de la santé sont considérables et se feront sentir encore longtemps après que la pandémie sera derrière nous. Le Canada doit s’attaquer à ce problème dès maintenant et planifier les mesures qu’il prendra pour soutenir le personnel de la santé une fois la pandémie terminée.
Toutefois, la pandémie n’est que partiellement responsable des effets néfastes sur la santé mentale et le bien-être que nous constatons chez le personnel de la santé. Même avant la pandémie, les conditions de travail dans le milieu de la santé entraînaient de nombreux problèmes de santé mentale. Une pénurie de main-d’oeuvre se traduit par une augmentation de la charge de travail, davantage d’heures supplémentaires et moins de temps pour offrir des soins de qualité aux patients. Les travailleurs qui en font les frais sont souvent des bas salariés ou des employés à temps partiel qui ont peu ou pas d’avantages sociaux, et qui sont majoritairement des femmes, des immigrants et des personnes racialisées.
Le Canada manque à ses obligations envers nos travailleurs des soins de santé et, par extension, envers la population canadienne. Comme nous l’avons constaté pendant cette pandémie, si la main-d’oeuvre du Canada n’est pas en santé, notre économie ne peut fonctionner correctement. Il en va de même pour notre système de santé. Les travailleurs des soins de santé sont la ressource la plus précieuse du système et si l’on en prend bien soin, l’on prend bien soin de tous les Canadiens.
Recommandation 4 : Veiller à la mise en place de soutiens et de programmes appropriés en matière de santé mentale afin d’aider les travailleurs de la santé, maintenant, et une fois la pandémie terminée. Il faut porter une attention particulière aux travailleurs de la santé qui n’ont pas accès à de l’aide et à des programmes en santé mentale par l’entremise d’un employeur, d’un organisme de réglementation ou d’un ordre professionnel. L’investissement dans la recherche en santé mentale qui mène au développement de produits et de services innovants, y compris des soutiens virtuels, est l’une des façons d’assurer un soutien à la santé mentale des travailleurs des soins de santé.
Recommandation 5 : De concert avec les parties prenantes, contrer les facteurs qui contribuent à l’augmentation du stress, de l’anxiété, de la dépression et de l’épuisement professionnel chez les travailleurs des soins de santé, comme les lourdes charges de travail, les heures supplémentaires en nombre excessif, les pénuries de personnel, l’incapacité d’occuper pleinement son champ d’exercice, les postes à temps partiel offrant peu ou pas d’avantages sociaux, les bas salaires et un manque de congés de maladie rémunérés. Ces mesures contribueront à améliorer le recrutement et la rétention du personnel dans le secteur, ce qui se traduira par de meilleurs soins aux patients et une population en meilleure santé.
Recommandation 6 : Mettre en oeuvre une stratégie nationale de ressources humaines en santé pour remédier à la pénurie de professionnels de la santé, créer un système de santé plus inclusif et plus résilient, et réaliser la promesse de votre gouvernement voulant que chaque Canadien ait accès à un médecin de famille ou à une équipe de soins de santé primaires.
Recommandation 7 : Augmenter les transferts en santé aux provinces et territoires et, au minimum, maintenir la part fédérale du financement au fil du temps.
MODERNISER L’INFRASTRUCTURE DES SOINS DE SANTÉ POUR CRÉER UN SYSTÈME DE SANTÉ PLUS RÉSILIENT ET PLUS ÉCOLOGIQUE
Les installations de soins de santé du Canada sont parmi les plus anciennes infrastructures publiques encore en utilisation. Près de 48 pour cent d’entre elles ont été construites il y a plus de 50 ans. La situation est pire dans les villes, où près de 70 pour cent de toutes les installations de soins de santé ont plus de 50 ans. Au cours des 20 dernières années, l’investissement en capital du Canada dans l’infrastructure en santé a fluctué et il a notablement diminué ces dernières années, malgré une augmentation constante de la dépense globale en soins de santé au cours de la même période3. On peut en conclure que les investissements en capital sont sacrifiés pour financer les dépenses opérationnelles. Une telle approche est à courte vue et ne fera qu’accroître la pression sur le système et détériorer les soins aux patients.
En plus d’être désuètes, les installations de soins de santé sont les installations les plus énergivores au Canada. Elles consomment environ 11 pour cent de toute l’énergie publique et sont responsables de quelque cinq pour cent des émissions de gaz à effet de serre du pays. Le défaut du Canada de maintenir des investissements adéquats dans ses installations de soins de santé nuit à notre environnement et compromet sérieusement notre capacité à soutenir un système de soins de santé innovant et technologiquement avancé. La pandémie de COVID-19 a montré brutalement que les infrastructures en santé désuètes du Canada mettent la santé des Canadiens en danger. La situation est particulièrement flagrante dans le secteur des soins de longue durée qui compte de nombreux établissements dans lesquels il est pratiquement impossible de se conformer aux protocoles de distanciation physique et d’isolement.
En plus d’améliorer notre infrastructure matérielle en santé, le Canada doit sérieusement s’engager à mettre en oeuvre une infrastructure numérique en santé qui rationalise le système de santé, facilite le partage sécurisé des données en santé avec les praticiens et les patients, et soutient les soins virtuels. La COVID-19 a entraîné une augmentation bien accueillie de l’utilisation des outils de soins virtuels et a mis en évidence les nombreux avantages des soins virtuels. Ce virage rapide a toutefois fait ressortir le besoin d’une infrastructure nationale en santé numérique plus robuste, dotée de plateformes de données interopérables capables de soutenir ce nouveau mode de prestation de soins et à laquelle les Canadiens peuvent faire confiance pour préserver la sécurité de leurs renseignements sensibles.
L’augmentation des soins virtuels s’est toutefois accompagnée d’une augmentation des cybermenaces, ce qui rend plus urgent le renforcement de la cybersécurité dans le secteur de la santé. Les organisations de soins de santé, partout dans le monde, ont subi des cyberattaques et les autorités ont mis en garde contre l’augmentation et l’imminence des menaces de cybercriminalité ciblant le secteur des soins de santé au cours des derniers mois. Les gouvernements doivent prioriser la cybersécurité dans le secteur de la santé pour assurer la prestation continue de soins de santé de qualité et protéger les données personnelles sensibles des Canadiens.
L’investissement dans l’infrastructure des soins de santé – tant matérielle que numérique – est une priorité dans l’édification de la nation. Cet investissement renforcera la résilience, la durabilité et l’équité du système de santé en augmentant l’accès aux services de santé; en luttant contre l’engorgement; en renforçant la capacité d’intervention rapide; en améliorant les capacités en matière de prévention et de contrôle des infections; en réduisant les coûts de fonctionnement du système de santé; en améliorant la qualité des soins; et en créant un système de santé davantage axé sur les patients. Au-delà du soutien à la santé des Canadiens, l’investissement dans l’infrastructure des soins de santé contribue à l’économie du Canada en créant des emplois; en stimulant les économies locales, provinciales et territoriales; en faisant croître le PIB du Canada; en augmentant l’efficacité, ce qui réduit les coûts des soins de santé; en catalysant l’innovation dans la prestation des soins de santé; en attirant les meilleurs talents et les investissements mondiaux dans la recherche et les soins aux patients; et en maintenant la compétitivité du Canada sur la scène mondiale.
Recommandation 8 : Moderniser les infrastructures en santé du Canada et au cours des cinq prochaines années, augmenter les investissements en capital dans les soins de santé à un minimum de 0,6 pour cent du PIB pour mieux aligner le Canada sur les comparateurs de l’OCDE. Cela comprend des investissements dans l’infrastructure matérielle, comme les hôpitaux, les installations de recherche et les établissements de soins de longue durée, ainsi que des investissements dans l’infrastructure de la santé numérique et de la cybersécurité.
CONCLUSION
Comme nous l’avons trop bien appris au cours de la dernière année, une population en santé et une économie saine vont de pair. L’investissement dans un système de santé qui fonctionne pour tous et qui tire parti de la force innovatrice et économique du secteur de la santé et des biosciences favorisera non seulement le fonctionnement de notre économie, mais aussi sa vigueur en créant des emplois, en stimulant les économies locales et en attirant les meilleurs talents et les investissements mondiaux.
RÉFÉRENCES
- Conseil sur la stratégie industrielle du Canada. (2020). Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens : Un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, durable et innovante. Consulté à : https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/vwapj/00118a_fr.pdf/$file/00118a_fr.pdf.
- Brophy, J. T., Keith, M. M., Hurley, M. & McArthur, J. E. (2021). Sacrificed: Ontario Healthcare Workers in the Time of COVID-19. NEW SOLUTIONS: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy, 30(4), 267–281. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/1048291120974358; Statistique Canada. (2021). La santé mentale chez les travailleurs de la santé au Canada pendant la pandémie de COVID-19. Consulté à : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210202/dq210202a-fra.htm.
- Teja B., Daniel I., Pink G.H., Brown A., Klein D.J. (2020). Ensuring adequate capital investment in Canadian health care. CMAJ Jun 2020, 192 (25) E677-E683. Consulté à : https://doi.org/10.1503/cmaj.191126.
PRÉSENTÉ
le 19 février 2021
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Bianca Carlone
Analyste des relations gouvernementales et des politiques
bcarlone@healthcarecan.dev2.inter-vision.ca
Jonathan Mitchell
Vice-président, Recherche et politiques
jmitchell@healthcarecan.dev2.inter-vision.ca
Related:
Mémoire présenté au gouvernement fédéral dans le cadre de la Consultation sur la puissance de calcul pour l’intelligence artificielle (IA)

Mémoire présenté au Comité permanent des finances dans le cadre des consultations prébudgétaires en vue du budget fédéral de 2025